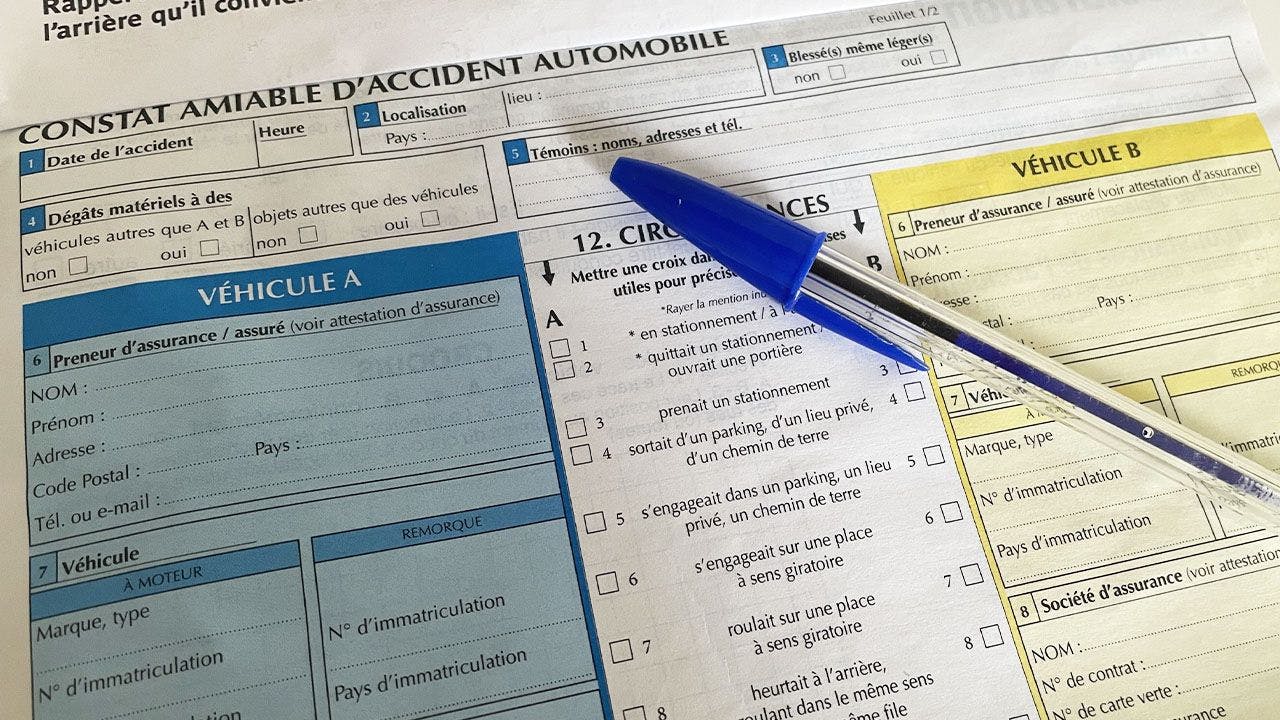D'où vient l'expression « partir sur les chapeaux de roue » ?
Partir sur les chapeaux de roue, c’est s’élancer avec force, parfois même avec une précipitation incontrôlée. Mais que viennent faire ces mystérieux « chapeaux » dans une expression qui fait référence aux roues d’une voiture ? L’image intrigue, et c’est sans doute ça qui a contribué à la popularité de l’expression. Levons le mystère !

Les chapeaux de roue, anciens enjoliveurs de l’automobile
Pour comprendre l’origine de l'expression, il faut remonter aux débuts de l’automobile, au tout début du 20ᵉ siècle. À cette époque, les « chapeaux de roue » désignaient ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’enjoliveurs : ces pièces métalliques qui cachaient la jante et finissaient la roue.
Lors d’un démarrage brutal ou d’un virage trop serré, ces chapeaux pouvaient frotter le sol, parfois même se détacher, donnant l’impression que la voiture bondissait avec une fougue telle que ses accessoires semblaient s’envoler. Cette image a marqué durablement les esprits.
Une expression qui illustre un départ rapide, voire précipité
Peu à peu, l’expression a quitté les garages pour entrer dans le langage courant. « Partir sur les chapeaux de roue » ne décrit plus seulement un départ automobile mal maîtrisé. L'expression illustre désormais tout commencement tonitruant, qu’il s’agisse d’un projet ambitieux, d’une carrière lancée tambour battant ou même d’une histoire d’amour démarrée avec passion. On y entend l’enthousiasme, mais aussi le risque de la précipitation.
Aujourd’hui encore, à chaque fois que l’on emploie cette expression, on convoque malgré soi l’image de ces voitures bondissantes et de leurs conducteurs téméraires. Un détail technique, celui d’un enjoliveur frottant le bitume, est ainsi devenu une métaphore universelle. Une preuve supplémentaire que la route et la mécanique n’ont pas seulement modelé notre quotidien : elles ont aussi enrichi notre langue et notre imaginaire collectif.