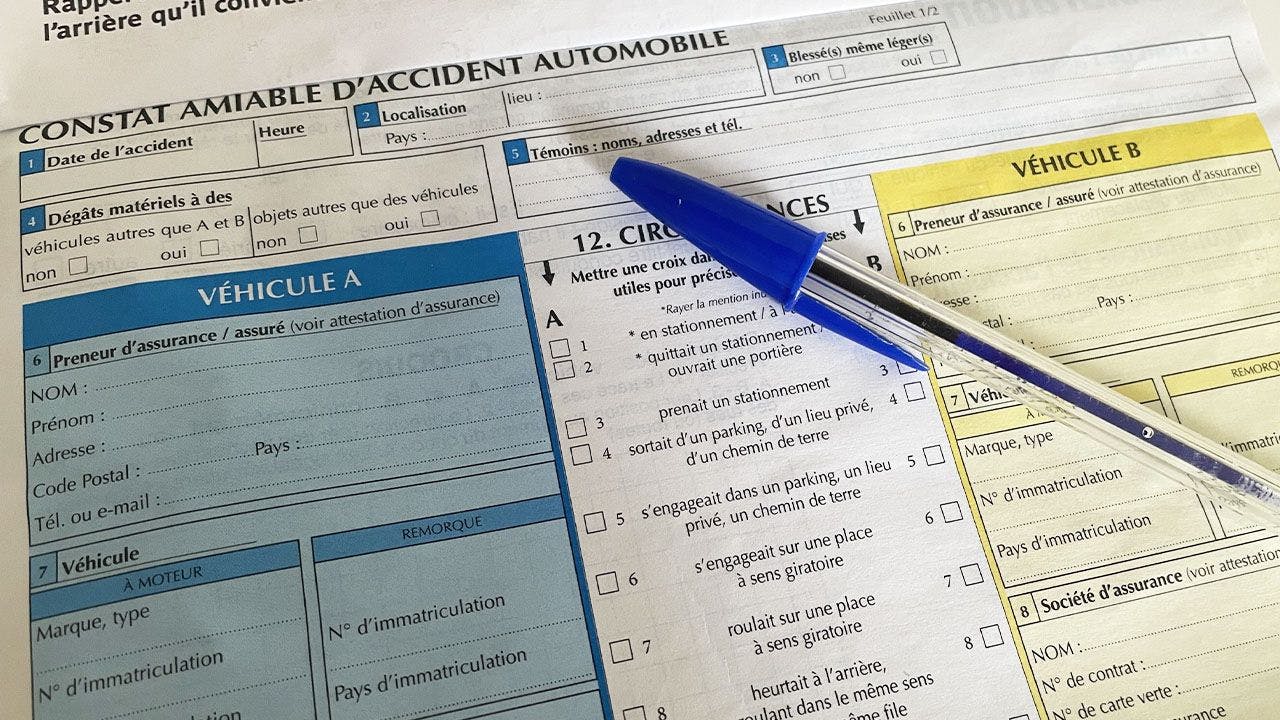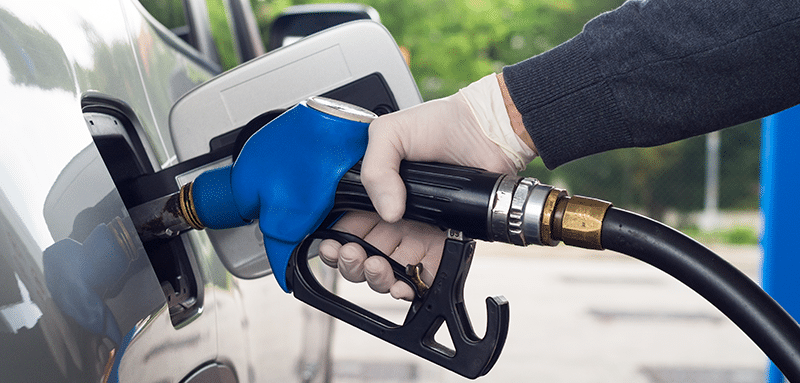Protoxyde d’azote : quels sont les risques du gaz hilarant au volant ?
L’usage récréatif du protoxyde d’azote – plus connu sous le nom de gaz hilarant – se diffuse de plus en plus, notamment parmi les jeunes conducteurs. Souvent perçu comme anodin, ce gaz euphorisant altère pourtant la vigilance et la coordination. Une banalisation qui inquiète les acteurs de la sécurité routière. Quels risques fait-il réellement courir au volant ? Et que prévoit aujourd’hui la réglementation ?

Ces derniers mois, plusieurs accidents tragiques ont mis en lumière les dangers du protoxyde d’azote au volant. Le phénomène est de moins en moins marginal : 10 % des jeunes de moins de 35 ans déclarent avoir déjà consommé du « proto », et la moitié d’entre eux reconnaissent l’avoir fait avant de conduire1↓. Cette réalité souligne l’urgence d'informer et de sensibiliser sur les effets de ce gaz, en particulier au volant.
Des effets semblables à ceux de l’alcool ou du cannabis au volant
Utilisé à l’origine en médecine, pour soulager la douleur, et en cuisine (dans les siphons à chantilly par exemple), le protoxyde d’azote est de plus en plus détourné à des fins récréatives. Inhalé, il prive temporairement le cerveau d’oxygène, provoquant une brève euphorie et une sensation de flottement.
Si l’euphorie dure à peine une minute, d’autres effets peuvent se faire sentir jusqu’à 45 minutes après la prise comme :
- Des vertiges ;
- Des trous noirs ;
- Une perte de contrôle et de coordination ;
- Un ralentissement des réflexes ;
- Des troubles de la vision (distorsion, vision floue).
Au volant, ces effets sont aussi dangereux que l’alcool ou le cannabis, et augmentent le risque d’accident.
Bon à savoir
La vente de protoxyde d’azote est interdite aux mineurs depuis 2021. Plusieurs villes (Nice, Cannes, Marseille, Tours, etc.) ont en plus pris des arrêtés pour interdire la détention, l’utilisation, la revente, voire la vente de protoxyde d’azote et l’abandon de cartouches sur la voie publique.
Gaz hilarant au volant : que dit la réglementation ?
Pour l’instant, aucune loi n’interdit explicitement la consommation de protoxyde d’azote au volant. Cette pratique est récente et la réglementation doit s’adapter. De plus, les tests salivaires ou sanguins utilisés lors des contrôles routiers ne détectent pas encore cette substance.
Mais cela ne signifie pas pour autant que la consommation de protoxyde d’azote est tolérée quand on conduit ! Pour rappel, l’article R412-6 du Code de la route prévoit que « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » et qu’il doit à « tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ». Or, ces obligations sont incompatibles avec la consommation de gaz hilarant.
De plus, en cas d’accident, le conducteur sous l’emprise du protoxyde d’azote peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui ou blessures involontaires. Le premier délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et la peine est deux fois plus lourde pour le second.
La nouvelle loi sur l’homicide routier pourrait durcir les sanctions. Le texte prévoit que la consommation de substances psychoactives à des fins détournées ou excessives devienne une circonstance aggravante. La liste des produits concernés, attendue pour 2026, devrait inclure le protoxyde d’azote. Les peines encourues seraient alors alourdies et le conducteur risquerait :
- 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende en cas d’homicide routier ;
- 5 ans et 75 000 euros d’amende en cas de blessures routières ayant entraîné une ITT (incapacité temporaire de travail) de moins de 3 mois ;
- 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende en cas de blessures routières ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois.
En attendant les sanctions, la prévention
Face aux dangers que représente le protoxyde d’azote sur la route, la Fondation Vinci lance une campagne de prévention1↓. Depuis le 24 octobre 2025, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et sur Internet alerte sur les effets du gaz hilarant au volant. Le spot s’accompagne d’une campagne d’affichage et d’une action de sensibilisation menée sur les aires de repos du groupe, en partenariat avec l’association Protoside.
L’Agence régionale de santé (ARS) mène aussi une campagne de prévention. Baptisée « C’est trop risqué d’en rire », cette action vise à informer les 15-25 ans sur les conséquences du protoxyde d’azote sur leur santé (risques de paralysie, de troubles neurologiques, vasculaires, psychiatriques, etc.).
Car c’est tout le paradoxe du protoxyde d’azote. Si les moins de 35 ans sont les plus susceptibles d’en consommer, ils sont peu informés des risques. D’après l’étude de la Fondation Vinci, 37 % des moins de 35 ans disent ne pas connaître ou ne pas connaître du tout la pratique quand 68 % des Français affirment voir « très précisément de quoi il s’agit ». Pourtant, 10 % des moins de 35 ans reconnaissent avoir déjà consommé du gaz hilarant, contre seulement 2 % des 35 ans et plus1↓.