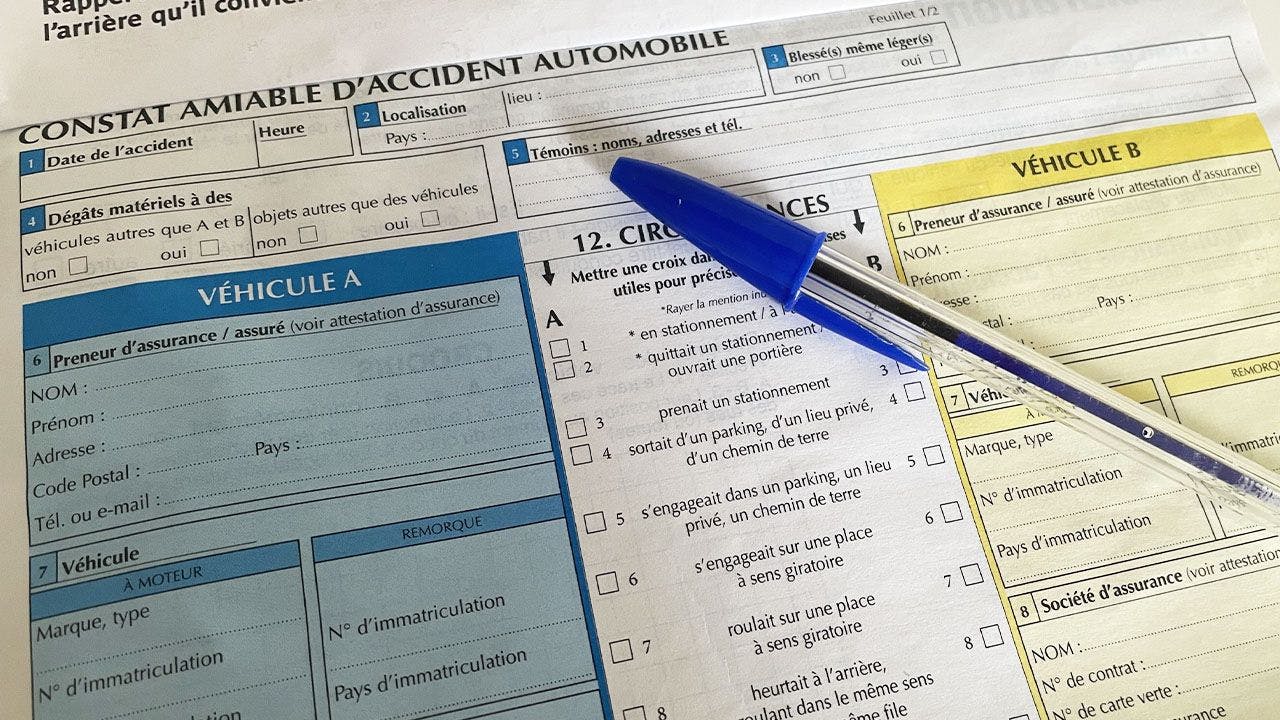450 000 ralentisseurs illégaux ? C'est beaucoup plus compliqué que ça !
Installés dans les villes et villages pour réduire la vitesse, les ralentisseurs sont devenus omniprésents. Mais sont-ils tous légaux ? Entre décret, normes, recommandations techniques et décisions de justice, la réponse est loin d’être évidente. Enquête sur le flou réglementaire qui règne autour de ce dispositif routier aussi courant que controversé.

Ralentisseurs : origine et cadre réglementaire
Les premiers ralentisseurs sont apparus en France dans les années 1980, sur le modèle des dispositifs américains et néerlandais. Leur usage s’est généralisé à partir de 1994 avec un cadre juridique précis : le décret n°94-447 du 27 mai 1994, ainsi que la norme NF P98-300 de l'AFNOR1↓, qui posent les bases réglementaires.
Seuls deux dispositifs géométriques sont cités dans ces textes :
- les ralentisseurs de type dos d’âne (longs et arrondis) ;
- les ralentisseurs de type trapézoïdal (surélevés et plus larges).
Les ralentisseurs doivent répondre à certaines règles d'implantation et de signalisation : ils ne peuvent être installés que sur des voies limitées à 30 km/h. Ils sont interdits à moins de 200 mètres des entrées et sorties d’agglomération, à proximité d’une section de route limitée à 70 km/h, dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres ainsi qu’en sortie de ces courbes. Leur implantation est également illégale sur les routes où le trafic dépasse 3 000 véhicules par jour, ainsi que sur les axes empruntés par des lignes de transport public ou des services de secours. Par ailleurs, un ralentisseur doit obligatoirement s’accompagner d’un autre aménagement visant à réduire la vitesse. Enfin, sa présence doit toujours être signalée par un panneau de signalisation.
Concernant leur géométrie et selon la norme AFNOR, ces deux types de ralentisseurs doivent avoir un plateau compris entre 2,5 et 4 mètres, avec deux pentes de 1 à 1,4 mètre de long et une hauteur maximale de 10 centimètres.
Bon à savoir
L’arrêté du 24 novembre 1994 n’indique pas de dimensions chiffrées (hauteur, longueur, pente, etc.) pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. Il encadre uniquement les critères d'implantation.
Le rôle du CEREMA et ses recommandations techniques
En 2010, le CERTU (aujourd'hui devenu le CEREMA2↓, établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique), a élaboré deux guides de recommandations sur les règles de construction de différents types de ralentisseurs. L'un porte sur les « ralentisseurs de type dos-d’âne et trapézoïdal » et l'autre sur trois autres types de surélévations : les coussins, les plateaux et les surélévations partielles. « En France, il y a d’un côté la réglementation, et de l’autre son application sur le terrain. Dans les faits, à son origine le décret de 1994 ne réglementait que deux types de ralentisseurs décrits dans le texte, laissant ouvert les autres dispositifs reconnus dans la réglementation de la signalisation routière (coussins, plateaux). Une communauté d’acteurs – experts, collectivités, techniciens – travaille sur ces dispositifs alternatifs et élabore des règles de l’art pour encadrer leur mise en œuvre, en s’appuyant sur les retours d’expérience », nous explique une source au sein du CEREMA.
Sauf que cette norme n’a pas de valeur réglementaire, contrairement aux textes de 1994. Résultat : un grand flou entre les recommandations techniques et les obligations légales. C'est la raison pour laquelle l'association Pour une mobilité sereine et durable (PUMSD) tire régulièrement la sonnette d’alarme. « Il faut bien distinguer deux choses : d’un côté, la règle d’implantation fixée par le décret de 1994, et de l’autre, les préconisations de construction élaborées par le Cerema, explique Thierry Modolo-Dominati, fondateur de l’association PUMSD. Or, ces recommandations n’ont jamais été publiées au Journal Officiel, ce qui les rend juridiquement inopposables. On ne peut pas contester un ralentisseur sur la base de ses dimensions, mais uniquement si son emplacement ne respecte pas les critères d'implantation définis par le décret. »
Des ralentisseurs vraiment illégaux ?
Depuis 30 ans, les ralentisseurs ont fleuri partout : routes communales, départementales, voies privées ouvertes à la circulation… sans forcément respecter les règles d’implantation. Certains sont mal placés, mal signalés, voire installés sur des routes où leur présence est interdite. C'est dans ce contexte que depuis plusieurs années, l'association Pour une mobilité sereine et durable, soutenue par la Ligue de défense des conducteurs, pointe du doigt le guide publié par le CEREMA, qui aurait semé la confusion.
Des ralentisseurs aux formes diverses, parfois éloignées du cadre légal, ont été installés sur tout le territoire. On les retrouve sous différentes appellations – plateaux surélevés, traversants, coussins berlinois ou lyonnais – sans garantie qu’ils respectent les exigences prévues par la réglementation initiale. « Le guide du CEREMA a été conçu par cet organisme d’État dans un seul but : contourner les contraintes du décret de 1994, qui est pourtant très strict, dénonce Thierry Modolo-Dominati. Si ce décret était appliqué à la lettre, l’installation de ralentisseurs serait impossible dans 99 % cas. C'est à cause d'eux qu'on se retrouve aujourd'hui avec 450 000 ralentisseurs illégaux en France, sachant qu'il s'en implante tous les jours. »
Un non-sens selon le CEREMA. « Les coussins et les plateaux n’ont pas la forme trapézoïdale du ralentisseur décrit dans le décret. Dans les années 1980-1990, tous ces dispositifs avaient pourtant été testés. Mais à l’époque, c’est surtout la prolifération de dos d’âne et de ralentisseurs trapézoïdaux mal conçus qui avait poussé à encadrer leur usage. C’est dans ce contexte que le décret a été rédigé, en ne mentionnant que ces deux formes, les autres étant encore très peu répandues sur les routes. Pourtant, la signalisation routière, elle, fait bien la distinction entre les plateaux, les coussins et les ralentisseurs classiques. »
Bon à savoir
La norme NF P98-300, bien que très détaillée et largement utilisée, n’est pas opposable juridiquement. En cas de contentieux, seul le décret de 1994 et l’arrêté associé font foi devant les tribunaux.
La récente décision du Conseil d'État relance la polémique
Face à cette prolifération de ralentisseurs non réglementaires au sens du décret de 1994, l'association PUMSD a multiplié les actions en justice. L’une d’elles est allée jusqu’au Conseil d’État, qui a rendu sa décision le 27 mars 2025. « Nous avons largement soutenu cette action pour rappeler qu’une réglementation existe bel et bien, et qu’elle doit être appliquée, rappelle Nathalie Troussard, secrétaire générale de la Ligue de défense des conducteurs. Tout a commencé par une première décision du tribunal administratif visant le département du Var. Puis la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé cette orientation. L’affaire a ensuite suivi un long parcours judiciaire, sur plusieurs années, jusqu’au Conseil d’État. Ce dernier a finalement tranché : quelle que soit l’appellation du ralentisseur, s’il adopte une forme trapézoïdale, il doit impérativement respecter les conditions d’implantation fixées par le décret de 1994. »
Sauf que selon le CEREMA, la plus haute juridiction administrative aurait reconnu non recevable la plainte déposée par l'Association. « Le Conseil d’État a simplement jugé irrecevable la demande de l’Association, qui réclamait la destruction de l’ensemble des ralentisseurs jugés illégaux. Il ne s’est jamais prononcé sur la légalité ou l’illégalité de ces dispositifs. » Le Conseil d’État ne se serait pas non plus prononcé sur la validité des règles techniques du décret de 1994 encadrant la construction des ralentisseurs. « Le Conseil d’État a simplement estimé que la présence d’un ralentisseur ne nuisait pas à l’intérêt général, tandis que leur suppression systématique pourrait, elle, en compromettre la préservation, poursuit un autre expert du CEREMA. La réglementation de 1994, quant à elle, n’a à aucun moment été remise en question. »
Il faut en finir avec l’idée reçue selon laquelle les collectivités agiraient de façon anarchique.
Expert du CEREMA.
Les municipalités dans le flou
Du côté des municipalités, la situation est floue, tant sur le plan réglementaire que technique. Face aux polémiques et aux débats juridiques, certaines collectivités se sentiraient désorientées, tiraillées entre la volonté d’assurer la sécurité routière et le respect de normes parfois complexes à interpréter. À la question de savoir si elles se basent uniquement sur les recommandations du CEREMA, la réponse est non pour ce dernier. « Les collectivités s’interrogent d’abord sur l’objet adapté à leur besoin : chaque type de ralentisseur a sa pertinence, souligne l'expert. Si une commune veut installer un dos d’âne, elle vérifie s’il est conforme au décret qui encadre ce type précis. Si elle opte pour un plateau, elle se réfère aux recommandations techniques correspondantes. Il faut en finir avec l’idée reçue selon laquelle les collectivités agiraient de façon anarchique. » Mais dans les faits, de nombreux ralentisseurs sont mal implantés.
Pas de démolition systématique
Le Conseil d’État a donc estimé qu’il revenait aux préfets et aux collectivités locales d’évaluer les situations au cas par cas, sans obligation générale de suppression. « Il n’existe aujourd’hui aucune obligation légale de démonter les ralentisseurs non conformes, confirme Nathalie Troussard, secrétaire générale de la Ligue de défense des conducteurs. En revanche, les élus qui les font installer en dehors du cadre réglementaire peuvent voir leur responsabilité engagée. En cas d’accident grave, cette responsabilité peut être pénale. L’élu peut alors se retourner contre l’entreprise chargée des travaux, car celle-ci a un devoir de conseil et d’information. Elle n’aurait jamais dû construire un dispositif non homologué sans alerter la collectivité. »
Concernant la facture liée à la suppression des ralentisseurs illégalement installés, les élus peuvent aussi partager les frais.
Des nuisances pointées du doigt mais une efficacité reconnue en ville
Nombreux sont les automobilistes à se plaindre de « dos d’âne » jugés non conformes. Trop hauts, trop courts, mal signalés ou installés dans des zones non autorisées, ils sont accusés de causer des dommages mécaniques : suspensions, échappements, voire châssis endommagés. Mais pas seulement, selon Thierry Modolo-Dominati. « Les ralentisseurs ont un impact direct sur la qualité de vie et l’environnement, mais aussi sur les habitations. Lorsqu’un ralentisseur est installé devant un bien, sa valeur peut chuter jusqu’à 25 %. Une étude menée en partenariat avec l’UTAC, au cours d’une journée complète de tests avec des véhicules standards, a également révélé une hausse significative des émissions : + 25 % de pollution et + 27 % de gaz à effet de serre lors du franchissement de ces ralentisseurs non conformes. »
Selon les experts, les ralentisseurs sont pourtant l’un des rares moyens efficaces pour réduire la vitesse en zone urbaine : « Dans certains cas, la réduction de la vitesse en milieu urbain ne peut être obtenue que par des aménagements spécifiques », peut-on lire dans le guide du CEREMA.