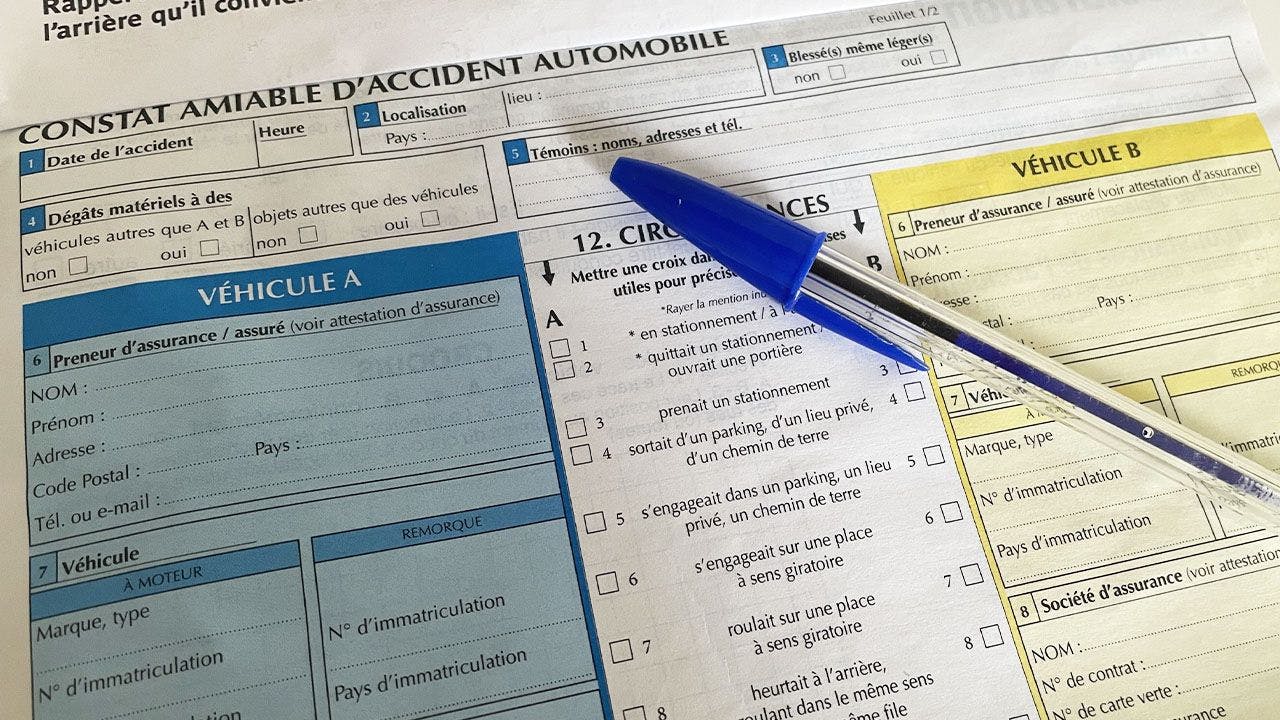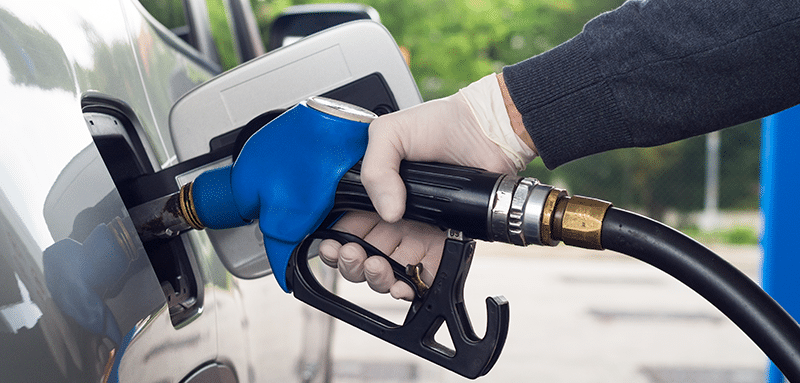Salon des Maires 2025 : comment les communes tentent de s’affranchir du « tout-voiture »
De nombreuses communes rurales testent de nouvelles solutions pour réduire la dépendance à la voiture. Au Salon des Maires 2025, plusieurs élus ont partagé leurs initiatives… et leurs difficultés pour les mettre en place. Découvrez notre micro-trottoir !
À l’approche des élections municipales, la mobilité s’impose comme l’un des grands enjeux dans les territoires ruraux. Embouteillages dans les centres-villes, « voitures ventouses », infrastructures routières envahissantes : les limites du « tout-voiture » se font sentir. Pourtant, changer les habitudes est un défi. Tour d’horizon des initiatives mises en
Bon à savoir
Selon une étude Roole menée avec l’Institut Bona fidé, 34 % des Français estiment que les mesures visant à réduire la place de la voiture en ville ont un impact négatif sur leur quotidien.
Une voiture essentielle mais… qui pose problème
Dans de nombreuses communes en France, le constat est le même : bien qu'elle soit indispensable au quotidien, la voiture occupe une place souvent démesurée dans l’espace public. Pollution de l’air, nuisances sonores, risques routiers… Les effets indésirables liés à l’automobile sont bien présents. « Il y a beaucoup d'autosolisme, c'est un sujet par rapport à la pollution…», souligne Jean-Yves Le Bars, Maire de Bellevigne-en-Layon (49).
« De grosses infrastructures traversent notre commune, une autoroute et deux nationales, avec un trafic très important, nous raconte Franck Villand, Maire de Porte-de-Savoie (73). C’est un avantage, car cela renforce l’attractivité économique, mais cela nous apporte aussi toutes les nuisances associées : pollution, bruit, risques… et cela coupe littéralement la commune en deux. » L’occupation prolongée de l’espace par les voitures est également source de tensions. À Cérons (33), le maire Jean-Patrick Soulé déplore la saturation autour de la gare. « On a une gare très fréquentée, tous les jours on a 300 voitures ventouses sur notre centre-ville », regrette-t-il.
Pour répondre à ces problématiques, les territoires sont encouragés à repenser les solutions de mobilité, les règles et les infrastructures : piétonnisation, développement des itinéraires cyclables, couloirs dédiés aux transports collectifs, dispositifs anti-bruit ou encore baisse progressive du nombre de places de stationnement en centre-ville. Autant d’outils pensés pour réduire l’impact de la voiture et redistribuer l’espace public.
Les mobilités douces pour redonner vie aux centres-bourgs
De nombreux élus misent sur les mobilités douces, désormais perçues comme un levier essentiel pour apaiser les déplacements. « On aménage des chemins de mobilité douce pour aider les gens à venir à pied et à vélo dans le centre-bourg », explique l’un d’eux. Ces aménagements, souvent pensés pour relier les hameaux dispersés au cœur de la commune, offrent une alternative simple et accessible.
Dans le même esprit, plusieurs villages instaurent des zones de rencontre, où la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h et où les piétons et cyclistes sont prioritaires.
Pour compléter les mobilités douces, les communes rurales cherchent aussi à enrichir leur offre de transports. « On essaye d’inciter les gens à prendre les navettes et à faire du covoiturage », détaille un élu. Ces services facilitent les trajets entre centres-bourgs, gares et zones d’activités, avec l’objectif de réduire l’autosolisme.
Certaines communes investissent également dans des véhicules adaptés aux usages locaux,
Pour limiter l’usage excessif de la voiture en centre-ville, des stratégies plus ciblées sont également mises en place. Les « parkings minutes », par exemple, permettent un stationnement rapide, « 5 à 10 minutes pour aller faire les courses », en évitant les voitures ventouses. Mais un maire nuance : « Plus on fait des parkings, plus on appelle la voiture », d’où l’intérêt d’investir simultanément dans d’autres modes de déplacement.
Une transition qui demande du temps…
Même si les initiatives se multiplient, leur adoption par les habitants n’est jamais immédiate. Les travaux, les nouveaux sens de circulation ou la réduction de la place de la voiture peuvent bousculer les habitudes. « Il y a quelques mois, ce n’était pas encore bien accueilli… mais aujourd’hui les retours sont positifs », constate Daniel Basset, Maire de Saint-Étienne-la-Varenne (69).
« Les gens n’aiment pas le changement. Après, on doit beaucoup communiquer », insiste Aline Gruet, maire de Pierre-de-Bresse (71). Concertations, réunions publiques, ateliers : la communication et la pédagogie deviennent deux outils essentiels pour faire accepter la transition et accompagner les habitants vers de nouveaux usages.