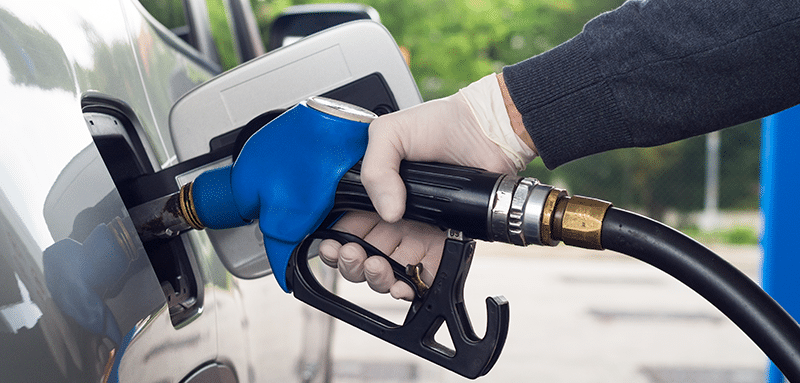Expérimentation sur les ZFE : trois villes, 51 familles et une leçon de justice sociale
À mesure que les Zones à faibles émissions s’étendent en France, de nombreuses voix s’élèvent pour alerter sur leurs impacts sociaux : les ménages les plus fragiles seraient les plus touchés par les restrictions de circulation imposées par ce dispositif. Une étude conduite par le cabinet Auxilia dans trois territoires démontre que l’expérimentation et l’accompagnement peuvent jouer un rôle décisif pour rendre la transition plus juste.

Réduire la pollution de l’air en ville en restreignant l’accès aux véhicules les plus polluants : sur le papier, la promesse des Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) paraît simple et nécessaire. Rendues obligatoires par la loi Climat et résilience en 2021, ces zones concernent depuis le 1er janvier 2025 les 42 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants. Au quotidien, environ 1 million d’automobilistes seraient directement concernés par les restrictions de circulation d’au moins une ZFE. Et en première ligne, les familles modestes, dépendantes à l’automobile et souvent contraintes de rouler avec des véhicules anciens – Crit’Air 4, 5 ou non classés – en raison d’un budget limité et d’un manque d’offres alternatives de mobilité.
Bon à savoir
Depuis le 1er janvier 2025, les voitures Crit’Air 3 ont rejoint la liste des véhicules interdits de circulation dans les ZFE de Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier.
Des expérimentations dans trois territoires
C’est pour analyser les impacts sur ces foyers modestes que le cabinet Auxilia a lancé entre 2022 et 2024 l’expérimentation Familles ZFE. Trois territoires aux profils contrastés ont été choisis : Lyon (ZFE déjà mise en place), Limoges (ZFE prévue, mais la ville a depuis été exonérée de l’obligation) et La Rochelle (territoire non concerné mais engagé dans une stratégie de réduction des usages automobiles).
Bon à savoir
La part des véhicules Crit’Air 4, 5 ou non classés en 2019 était de 12% à La Rochelle, 11,8% à Limoges et de 8,2% à Lyon (chiffres : Auxilia et SDES).
Pour mener cette expérimentation, 51 ménages précaires vivant en zones périurbaines, dans des communes éloignées ou dans des quartiers prioritaires (QPV) en centre-ville, ont été recrutés pour tester gratuitement des solutions alternatives à la voiture individuelle dans les trois agglomérations. « L’objectif était de (…) permettre aux ménages d’accéder à une grande diversité de solutions de mobilité, de les tester selon leurs besoins et leurs trajets, (…) pour les convaincre de renoncer, temporairement et sur un ou plusieurs motifs de déplacements, à leur voiture », précise le rapport d’Auxilia. Les ménages ont ainsi pu bénéficier de diagnostics de mobilité personnalisés, d’une présentation et d’une facilitation d’accès aux transports en commun, à l’autopartage, au covoiturage ou encore à un vélo à assistance électrique.
L’accompagnement personnalisé, un levier de changement
Premier enseignement de cette étude : la voiture reste un mode de déplacement majeur sur les trois territoires ciblés mais lorsque ces ménages sont accompagnés, écoutés et bénéficient de tests, les comportements de mobilité évoluent. « L’expérimentation permet aux personnes de se rendre compte très concrètement du coût de la voiture au quotidien et des dépenses évitées lors de la phase de test. Cela contribue à les inciter à pérenniser l’utilisation de ces nouveaux modes de transport après l’exploration », précise le rapport. À La Rochelle, un couple habitué à louer une voiture au mois a fini par y renoncer, préférant l’autopartage et les bus, avec à la clé une économie de 400 € par mois. À Limoges, une mère de famille a continué à prendre le bus pour aller chercher son enfant à l’école, même après la fin du programme. D’autres, à Lyon ou La Rochelle, ont découvert les aides à l’achat d’un vélo électrique ou se sont renseignés sur les formules d’abonnement aux transports en commun.
Le suivi individualisé, les appels réguliers, les échanges sur les besoins réels et la mise en relation avec les opérateurs de mobilité ont permis à ces ménages de s’imprégner de nouvelles habitudes et de lever des freins psychologiques (peur du vélo, appréhension du numérique) et logistiques (problèmes d’horaires, méconnaissance des aides).
Fracture numérique, horaires, sécurité : encore des freins à lever
L’expérimentation révèle toutefois les limites des solutions proposées si elles ne sont pas pleinement adaptées. Certaines familles ont abandonné l’idée de tester l’autopartage, rebutées par la complexité des interfaces numériques ou par les conditions d’accès. Le vélo, même électrique, reste perçu comme risqué en ville, surtout avec des enfants. Quant aux transports en commun, ils peinent à répondre aux contraintes d’horaires décalés, aux trajets avec de nombreux changements ou aux activités multiples.
Bon à savoir
Selon le baromètre Wimoov publié en septembre 2024, 15 millions de Français sont en situation de précarité de mobilité en raison de leur situation socio-économique.
Plus largement, l’étude met en évidence le manque d’infrastructures adaptées, la faible interopérabilité entre les différents acteurs territoriaux et l’absence d’un guichet unique d’information. Autant de facteurs qui découragent le passage à d’autres modes. Une autre fragilité, moins visible, concerne les territoires eux-mêmes. Certaines communes périphériques, hors du périmètre des ZFE mais en interaction quotidienne avec les centres urbains, ne bénéficient d’aucun dispositif d’accompagnement. Pourtant, leurs habitants sont souvent parmi les plus exposés.
L’étude Familles ZFE attire l’attention sur le fait que l’acceptabilité d’une politique de transition se construit dans l’expérience. Tester des alternatives, en étant accompagné, dans un cadre souple et bienveillant, permet non seulement de lever des freins, mais aussi de répondre concrètement aux contraintes des usagers et leur apporter des solutions.
Bon à savoir
Dans de nombreuses ZFE déjà en vigueur en France, les collectivités ont fait le choix de proposer des dérogations temporaires, grâce à des pass jusqu’à 52 jours par an, ou des dérogations pour les « petits rouleurs ».
Face aux échéances réglementaires, les auteurs de l’étude appellent à intégrer systématiquement une évaluation socio-spatiale approfondie avant la mise en place d’une politique de restriction de circulation, à renforcer l’accompagnement social, à mieux cibler les aides (pas uniquement financières), à développer les coopérations entre collectivités, acteurs de la mobilité et du social, et à massifier l’accompagnement et le conseil mobilité, sans oublier les ménages les plus éloignés des centres-villes. Autant de clés pour rendre les ZFE – et les autres mesures de lutte pour la qualité de l’air – socialement acceptables. « L’exploration “familles ZFE” nous a permis d’identifier plusieurs tensions à l’œuvre entre l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air porté par les ZFE et le risque social que ces dernières font peser sur les ménages concernés. Si nous avons su développer plusieurs outils afin d’anticiper et de limiter ce risque (…) il nous paraît nécessaire de ne pas cantonner l’enjeu indispensable de l’amélioration de qualité de l’air aux seules ZFE mais bien d’agir plus largement en faveur de la réduction de la place de la voiture afin de répartir de manière plus égalitaire les efforts demandés », conclut Marc Fontanès, directeur général adjoint en charge des expertises Mobilités chez Auxilia.