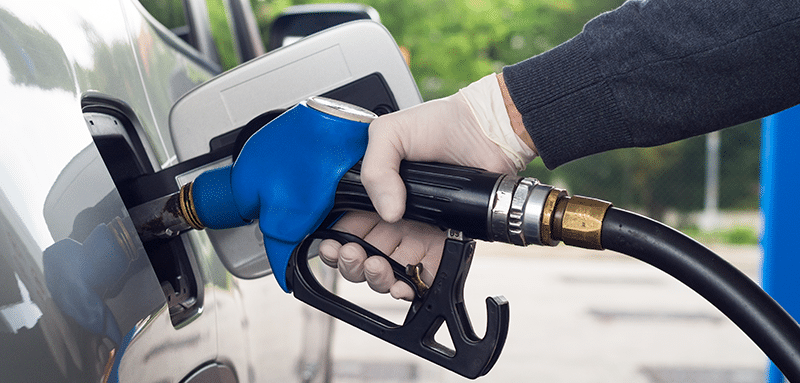Pluie d’idées reçues sur les ZFE : on démêle le vrai du faux
Depuis janvier 2025, les Zones à faibles émissions (ZFE) sont au cœur des débats et alimentent de nombreuses idées reçues. Suppression actée, exclusion de millions d’automobilistes, impact sur les plus modestes… Qu’en est-il vraiment ? On fait le tri entre réalité et fake news.

Les Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sont au cœur des débats depuis le début de l’année 2025. Alors que leur avenir semble incertain, de nombreuses informations, parfois erronées, circulent sur leur mise en œuvre et leurs impacts. Entre idées reçues et fake news, difficile de démêler le vrai du faux. Faisons le point sur ce qui est réellement en jeu.
« Les ZFE sont officiellement supprimées » : faux
Non, les Zones à faibles émissions (ZFE) ne sont pas officiellement supprimées. Le mercredi 26 mars 2025, les députés ont voté pour la suppression de la mise en œuvre des ZFE dans le cadre de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique en commission spéciale. Mais le texte ne sera examiné en séance publique qu’à partir du mardi 8 avril. Pour l’instant, les ZFE sont sur la sellette, mais rien n’est acté.
Le jeudi 3 avril, le gouvernement a déposé un amendement visant à restaurer les ZFE et à réformer le cadre légal de ce dispositif, en ciblant l'obligation de la mise en œuvre sur Paris et Lyon et en laissant aux autres collectivités la liberté de préserver leur ZFE ou non, avec une période d'adaptation et d'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2026. Il est donc probable que le dispositif soit maintenu, avec des adaptations et aménagements.
Si les ZFE étaient supprimées, la France aurait à y perdre, car ce dispositif a été créé pour répondre aux obligations réglementaires fixées par l’Union européenne en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Il y a quelques jours, nos confrères de Contexte ont révélé une note du Trésor soulignant que le retrait des ZFE pourrait priver la France de 3,3 milliards d’aides européennes en 2025. « Il est dans l’intérêt des autorités françaises de conserver les dispositions portant sur les ZFE », estime le Trésor dans sa note. La ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher a annoncé l’organisation fin avril d’un « Roquelaure de la qualité de l’air », lors duquel les élus des territoires concernés par les ZFE, les ministres de la santé et de l’aménagement du territoire se concerteront pour identifier des solutions concrètes pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les zones urbaines.
« 13 millions de Français sont exclus des ZFE » : faux
Les opposants aux ZFE avancent souvent le chiffre de 13 millions de véhicules concernés par les ZFE. Le compte est-il bon ? Pas du tout.
Si l'on prend l’ensemble des voitures Crit’Air 3, 4, 5 et non classées du parc automobile français au 1er janvier 2024, on tombe sur 11 millions (sur près de 40 millions de véhicules au total). Mais ce chiffre a pour périmètre le territoire entier. Il inclut les automobilistes qui ne sont pas directement concernés par une ZFE : ceux qui vivent dans des villes de moins de 150 000 habitants et dans les zones rurales. Or 88 % des communes françaises sont des communes rurales, qui réunissent 33 % de la population (chiffres Insee, 2021).
De plus, seules 4 agglomérations françaises interdisent la circulation des voitures Crit’Air 3 dans leur ZFE : Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier (où un moratoire voté en février 2025 suspend les sanctions jusqu’en 2027). La majorité des ZFE mises en œuvre au 1er janvier 2025 n’interdisent que les véhicules non classés, soit les voitures immatriculées avant le 1er janvier 1997. Or à l’échelle de la France, les véhicules non classés ne représentent que 2,5 % du parc automobile global (moins d'un million de véhicules au 1er janvier 2024).
Environ 2 millions d’automobilistes exclus des ZFE
Il est difficile d’estimer le nombre exact d’automobilistes concernés par les ZFE en France, mais ce qui est certain, c’est qu’ils ne sont pas 13 millions, ni même 11 millions. Selon le Service des données et études statistiques (SDES, 2024), sur les deux « territoires ZFE » que sont Paris et Lyon, on a un parc global de 3,2 millions de voitures, dont 22,5 % sont Crit’Air 3, 4, 5 et non classées. Les véhicules Crit’Air 0 et 1 représentent quant à eux 47,3 % des voitures sur ces deux territoires. À Lyon, environ 83 000 automobilistes (Insee) seraient exclus de la ZFE, et à Paris, ils seraient autour de 600 000. À Grenoble, l’Insee estime que 58 500 véhicules particuliers sont interdits de circulation dans la ZFE depuis le 1er janvier 2025. Si l'on prend compte des véhicules concernés dans les aires d'attraction des 4 principales ZFE, plus de 1,4 million de véhicules sont exclus à Paris, plus de 300 000 à Lyon, 125 000 à Montpellier et 104 000 à Grenoble.
Et ailleurs en France ? « Au 1er janvier 2024, 8,6 millions de voitures particulières sont détenues par les résidents des 40 autres agglomérations [concernées par les ZFE] », souligne le SDES. Parmi ces 8,6 millions de voitures, 1,7 % sont non classées et 0,9 % sont Crit’Air 5, soit 223 600 de voitures. Même en élargissant aux aires d'attraction des agglomérations, on arrive à 226 000 véhicules concernés là où les Crit'Air 4, 5 et non classés sont exclus (en additionnant Marseille, Toulouse, Strasbourg, Rouen et Reims). Dans toutes les autres ZFE, on arrive à moins de 100 000 véhicules concernés.
Sur la base de ces estimations, il y aurait entre 2 et 2,4 millions d’automobilistes directement concernés par des restrictions de circulation dans les ZFE françaises. Et il s’agit d’une estimation haute, car dans les faits, 16 agglomérations concernées n’ont pas encore mis en œuvre leur ZFE. Sans compter le moratoire à Montpellier et une dérogation permanente à Dijon, qui autorisent tous les véhicules à circuler.
« Les ZFE pénalisent les plus modestes » : plutôt vrai
Les Zones à faibles émissions sont très souvent accusées d’être des « zones à forte exclusion ». Et pour cause ! Ce sont les ménages les plus modestes qui possèdent les véhicules les plus anciens et donc les plus polluants : « Les voitures des 10 % de ménages les plus modestes sont âgées en moyenne de 13,8 ans et 6 véhicules sur 10 sont diesel », soulignent les données du SDES en 2024. En comparaison, chez les 10 % des ménages les plus aisés, l’âge moyen des véhicules est de 9,4 ans et 4 voitures sur 10 sont des diesel. « La part de véhicules Crit’Air 1 est ainsi 2,3 fois plus élevée dans le parc des 10 % de ménages les plus aisés (41 %) que dans celui des 10 % les plus modestes (18 %) », est-il précisé. Autre chiffre marquant : la moitié des voitures des ménages les plus modestes sont classées Crit’Air 3 ou plus et sont donc concernées par les restrictions de circulation des ZFE.
Bon à savoir
46 % des ménages du 1er décile de revenus (les 10 % les plus modestes) ne possèdent pas de voiture.
Mais pour éviter cette fracture sociale, de nombreuses agglomérations prévoient des dérogations « petits rouleurs » pour les automobilistes qui roulent peu (généralement autour de 10 000 km par an). Plusieurs villes comme Paris, Lyon, Rouen, Strasbourg, Montpellier, ou encore Grenoble, proposent également des « pass » journaliers pour permettre aux automobilistes exclus de la ZFE d’y circuler ponctuellement, jusqu’à 52 jours par an selon les villes.
Les plus modestes sont les plus exposés à la pollution atmosphérique
Par ailleurs, il est important de souligner que les bienfaits des ZFE bénéficient en particulier à ces mêmes ménages les plus modestes : « Les moins aisés vivent plus souvent au sein des aires d’attraction des villes, dans les communes les plus polluées : au sein de ces espaces, ce sont les enfants des ménages les plus modestes qui sont les plus exposés [à la pollution aux particules fines] du fait de leur localisation », rappelle la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dans une étude publiée en 2024.
« Il faut acheter une voiture neuve pour continuer à rouler dans les ZFE » : faux
Il n’est pas nécessaire d’acheter un modèle neuf ou électrique pour être autorisé à rouler dans une ZFE, même dans les agglomérations les plus avancées dans leur calendrier. Il est tout à fait possible d’opter pour une voiture d’occasion récente (Crit’Air 1 ou 2).
- Crit’Air 1 (violette) : toutes les voitures gaz, les voitures hybrides rechargeables et les voitures essence Euro 5 et 6 (immatriculées à partir du 1er janvier 2011).
- Crit’Air 2 (jaune) : les véhicules essence Euro 4 (immatriculées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 inclus) et les voitures diesel Euro 5 et 6 (immatriculées à partir du 1er janvier 2011).
Dans certaines métropoles, il existe des aides locales pour remplacer une voiture ancienne par une voiture électrique, Crit’Air 1 ou 2. Dans la majorité des cas, ces aides financières (soumises à conditions de revenus) qui s’appliquent à l’achat d’une voiture neuve concernent également les voitures d’occasion. C’est le cas notamment à Grenoble, Reims, Lyon, Paris, Rouen et Toulouse. Pensez à consulter le site web de votre métropole et/ou de votre région pour savoir si vous pouvez en bénéficier !
Et pour ceux qui ne peuvent pas tout de suite changer de voiture, des dérogations permanentes et temporaires sont souvent prévues dans les ZFE. « Pass » journaliers, dérogation « petit rouleur », dérogation pour les véhicules de collection, alternatives à la voiture individuelle… Pensez à consulter nos articles sur les ZFE françaises et le site web de votre métropole pour prendre connaissance de toutes les modalités de la Zone à faibles émissions qui vous concerne.
« Aucune sanction n’est appliquée donc les ZFE ne servent à rien » : pas tout à fait vrai
Théoriquement, un automobiliste qui circule dans le périmètre d’une ZFE avec un véhicule qui en est exclu s’expose à une amende forfaitaire de 68 euros. Mais dans les faits, peu de sanctions sont réellement appliquées. En cause : le retard de déploiement du système de contrôle automatique avec lecture de plaques d’immatriculation. D’après le gouvernement, ces radars devraient être déployés au plus tôt courant 2026 mais en attendant, quand il y a des contrôles (très rarement), ils sont réalisés par les forces de l’ordre.
Bon à savoir
Avoir une vignette Crit’Air est obligatoire pour rouler dans une ZFE ! Circuler sans vignette Crit’Air dans une zone réglementée vous expose à une amende forfaitaire de 68 euros.
En revanche, ce n’est pas parce qu'il y a peu de contrôles que les ZFE n’ont aucun impact. Dans la Métropole du Grand Paris, « sur les 42 % de baisse des émissions d’oxydes d’azote (NOx) dues au trafic routier entre 2017 et 2023, 6 % seraient attribuables à la ZFE-m », indique Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France. Concernant les particules fines, « 3 % de baisse des émissions seraient liées à la mise en place de la ZFE-m sur les 32 % constatées ».
« Les ZFE sont imposées même quand elles ne sont pas nécessaires » : faux
Non, les ZFE ne sont pas imposées là où elles ne sont pas nécessaires. La loi Climat et résilience de 2021, impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en œuvre une Zone à faibles émissions. Mais le niveau de restriction est adapté au niveau de pollution atmosphérique mesuré dans chaque ZFE. Paris et Lyon sont les deux seules métropoles françaises à devoir interdire les véhicules Crit’Air 3 depuis le 1er janvier 2025. Les 40 autres agglomérations ont en théorie pour seule obligation réglementaire de définir un périmètre pour leur ZFE et d’y interdire la circulation des véhicules non classés.
Et parmi ces 40 agglomérations, trois ont été exemptées d’instaurer une ZFE car elles ont prouvé que les niveaux de concentration en polluants étaient bien en dessous des seuils réglementaires : il s’agit de Limoges, Orléans et Le Mans.
« Les ZFE sont appliquées brutalement et sans préavis » : plutôt faux
La mise en place des Zones à faibles émissions est progressive, avec des calendriers échelonnés sur plusieurs années et des phases pédagogiques, lors desquelles aucune sanction n’est appliquée. À Paris, au début de la mise en œuvre de la ZFE en 2019, seuls les véhicules Crit’Air 5 et non classés étaient exclus. Les Crit’Air 4 ont été interdits en 2021, et ce n’est que 4 ans plus tard que les Crit’Air 3 ont été ajoutés à la liste. L’application progressive de ces ZFE laisse aux habitants le temps de comprendre le dispositif et de s’y adapter, en optant pour un véhicule plus récent ou en adoptant de nouveaux réflexes en matière de mobilité (transports en commun, covoiturage, mobilités douces…).
Certaines villes reportent ou adaptent leur calendrier au fil des années, en fonction de ce qui est observé dans l’application du dispositif. C’est le cas de Paris, qui a reporté plusieurs fois l’interdiction des voitures Crit’Air 3, de Strasbourg, qui a reporté l’interdiction des Crit’Air 3 à 2027, ou plus récemment de Grenoble, qui a annoncé le report de l’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 2 à 2028.
« Les ZFE sont inefficaces pour la qualité de l’air » : faux
Le 26 mars dernier, à la suite du vote des députés en commission spéciale, le député Rassemblement national Pierre Meurin a déclaré : « Les ZFE sont inutiles pour améliorer la qualité de l’air (…). » C’est faux. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, les Zones à faibles émissions ne sont pas un dispositif créé pour limiter les impacts sur le climat. Elles ont été spécifiquement pensées pour réduire la pollution atmosphérique, à l’origine de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Il s’agit donc de santé publique : chaque année en France, on compte 40 000 décès prématurés dus à la pollution de l’air. En 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour avoir, depuis 2010, dépassé de manière systématique la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote. C’est en réponse à cette condamnation que la création des ZFE a été introduite pour la première fois dans la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019.
Partout où des ZFE (ou dispositif équivalent à l’étranger) ont été mises en place, des améliorations notables de la qualité de l’air ont été mesurées. En Europe, il existe plus de 300 ZFE ! À Londres, l’Ultra Low Emission Zone (ULEZ) mise en place en 2019 a porté ses fruits : la capitale britannique mesure une diminution de 20 % de la concentration de dioxyde d’azote (NO2) sur l’ensemble de l’ULEZ et jusqu’à 44 % dans le centre de la ville. À Berlin, une réduction de 10,5 % des émissions de particules fines PM10 est enregistrée à proximité des axes routiers. Et la ville de Madrid mesure une baisse de 23 à 34 % du dioxyde d’azote dans l’air depuis la mise en place de sa Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en 2021.