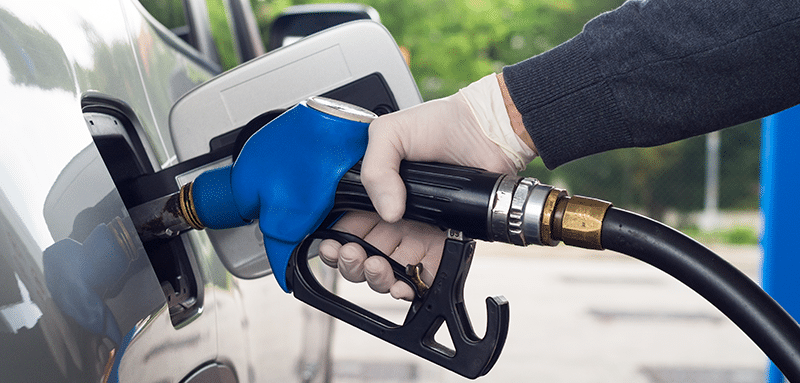L’auto-stop fait sa mue digitale : du pouce levé aux applis
Après des années de disgrâce, la pratique de l’auto-stop retrouve des couleurs. Grâce aux applications de géolocalisation, aux lignes de covoiturage organisées ou aux simples réseaux de confiance. Le bon vieux « pouce levé » redevient source de mobilité facile, économique et conviviale. Tour d’horizon des solutions disponibles en France

Auto-stop : que dit le Code de la route ?
Faire du stop en France n’est pas encadré par une réglementation spécifique. Les auto-stoppeurs doivent respecter le code de la route. Il est donc interdit de faire du stop sur des bretelles d’accès à l’autoroute, ni sur les bandes d’arrêt d’urgence, zones interdites aux piétons. La pratique est en revanche tolérée sur les aires de repos. Il faut que les automobilistes susceptibles de s’arrêter puissent le faire en toute sécurité.
Sur les routes secondaires, les auto-stoppeurs ont davantage de liberté pour solliciter de l’aide à condition de ne pas empiéter sur la chaussée, au risque de représenter un danger et sanctionné de 38 € d’amende.
Auto-stop : un peu d'histoire
A la fin des années 30, le « pouce levé » devient le symbole de système D pour se déplacer plus rapidement, à une époque où l’automobile est rare et les prix des billets de car et de train trop élevés. Les années 60-70 marquent l’âge d’or de l’auto-stop. Mais l’accès progressif à l’automobile et aux cyclomoteurs ainsi que de dramatiques faits divers détournent les Français de cette pratique.
Mais au tournant des années 2010, l’auto-stop redevient tendance, en particulier en milieu rural et en zone montagneuse. Motivées par la volonté de couvrir davantage leur territoire et rendre le service public de transport accessible au plus grand nombre, certaines communes et collectivités locales facilitent l’essor de cette pratique. Dans le souci de contenir l’autosolisme - le fait de conduire seul dans son véhicule - et les émissions de CO2 qui en découlent, les élus coopèrent avec des associations pour organiser la mise en relation entre passagers et conducteurs.
Des réseaux de confiance
Le réseau Mobicoop-Rezo Pouce, le plus développé en France (qui recense une centaine de communautés de communes). « Il s’agit d’un maillage de panneaux de signalisation comme des arrêts de bus, des totems au pied desquels les autostoppeurs se positionnent avec leur pancarte de destination, explique Bénédicte Rozes, présidente de Mobicoop. Les conducteurs qui le souhaitent peuvent alors s’arrêter pour les prendre. Bien qu’une application Rezo Pouce existe, il n’est pas obligatoire de s’y inscrire. Il n’y a pas d’échange monétaire imposé, le principe de liberté et d’entraide domine dans notre approche. » Créé en 2020, Rezo Pouce est devenu un écosystème reconnu de mobilité partagée qui met en confiance conducteurs comme passagers.
Autre approche solidaire, libre et gratuite, Halt ô Stop tisse sa toile depuis 2023, avec une centaine de panneaux de bois installés dans le Puy-de-Dôme, le massif du Sancy, le Périgord et le Genevois français. « Notre démarche est low tech et respectueuse de l’environnement, dans l’esprit initial de l’auto-stop, explique Loan Momboisse, le créateur. Notre mobilier urbain est en chêne issu des forêts avoisinantes, gravé et habillé de matériaux durables et fabriqué par des ouvriers en insertion. Nos panneaux s’intègrent idéalement dans le paysage rural et font désormais partie de la vie quotidienne des habitants. » Petite originalité, des étiquettes au nom des destinations alentours sont incorporées dans ces arrêts-stop pour faciliter la prise d’information des automobilistes. Le service n’est attaché à aucune application numérique.
De l’autostop au covoiturage organisé
Aménager ces points de prise en charge sur le bord des routes permet de mieux structurer un service par définition imprévisible et spontané. Il accroît en outre le sentiment de sécurité des usagers. En parallèle des nouvelles pratiques de l’auto-stop (occasionnel, libre, solidaire et gratuit), le covoiturage organisé (utilisation récurrente, distances plus longues et intérêt financier pour le chauffeur) se développe dans de nombreux bassins de vie.
La solution Ecov a ainsi été lancée en 2020 dans l’agglomération de Grenoble : complémentaires aux réseaux de bus, de véritables petites lignes de covoiturage ont ainsi vu le jour sur les axes les plus fréquentés.
Depuis une vingtaine d’années, l’association Ehop accompagne l’organisation des déplacements domicile-travail ou pour les loisirs en Bretagne. Les mises en contact sont effectuées via une plateforme téléphonique (pas d’interface numérique) à condition d’anticiper son trajet de 24 à 48 heures. Dans les deux cas, les usagers sont invités à partager les frais kilométriques (autour de 0,10 €/ km) avec leurs conducteurs.
Quand l’auto-stop se digitalise
Depuis 2017, des applications hybrides entre auto-stop et covoiturage spontané, fonctionnant sur base de géolocalisation, sont apparues à l’image de Tripeez ou BlablaCar Daily, qui sont des services flexibles et payants.
Plus innovante, la dernière-née Noula : « Nous digitalisons l’autostop dans une société où seulement 3% des déplacements du quotidien se font en covoiturage » résume Yahia Hajji, le créateur de Noula, dont l’originalité repose sur son fonctionnement exclusivement via la messagerie WhatsApp. « Installer une nouvelle application sur son smartphone, s’enregistrer avec mot de passe devient un frein, surtout pour les personnes peu à l’aise avec le numérique. Nous misons donc sur cette messagerie renforcée par une IA conversationnelle pour être plus réactifs avec les passagers et les conducteurs. » Néanmoins, une tarification est prévue pour inciter la communauté de chauffeurs à grandir (0,20 €/km). Le prix défini est annoncé à l’autostoppeur avant chaque prise en charge. Ce service né dans les DROM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) compte 25 000 utilisateurs et va s’installer dans la région lilloise, via des partenariats avec les entreprises pour organiser les trajets domicile-travail.
Loin de l’image vieillotte des années 70, l’autostop fait sa mue à travers ces différentes solutions locales, même s’il faut encore rassurer et encadrer pour élargir la pratique au-delà des territoires isolés et ruraux. Mais face aux difficultés économiques et aux incitations à réduire les émissions de CO2, la prise de conscience en faveur de cette mobilité partagée et le plus souvent conviviale ne peut que s’accélérer.